Le colloque sur la recherche transdisciplinaire à l’Université de Kinshasa s’est clôturé sur une note d’engagement et de lucidité, marquée par des interventions denses et prospectives. Les échanges ont mis en lumière la nécessité de repenser les dynamiques de production scientifique pour répondre efficacement aux défis complexes de nos sociétés contemporaines.
Défis et contraintes de la transdisciplinarité
Ouvrant la série d’interventions, le Professeur Bakari Amuri a dressé un tableau critique des contraintes majeures freinant l’émergence des projets inter et transdisciplinaires. Parmi celles-ci figurent l’incompatibilité des objectifs, les conflits de leadership, la logique de financement disciplinaire, ainsi que la complexité épistémologique propre à l’hybridation des savoirs. Il a également insisté sur le manque de confiance entre institutions académiques et société civile, freinant la construction de synergies durables au service du développement.
De la recherche au développement : l’exemple du médicament
Dans une approche plus appliquée, le Professeur Patrick Memvanga a illustré le processus de développement d’un médicament, depuis la phase préclinique jusqu’à la commercialisation. Son exposé a démontré combien la collaboration entre chimistes, biologistes, médecins, pharmaciens et économistes est indispensable pour garantir l’efficacité et la viabilité d’un produit thérapeutique.
Pour une recherche inclusive et équitable
Madame Marie-Madeleine Phoba a, pour sa part, attiré l’attention sur la marginalisation des femmes et des personnes vivant avec handicap dans les dynamiques de recherche interdisciplinaire. Selon elle, cette exclusion résulte de stéréotypes sociaux profondément ancrés et d’une sous-représentation institutionnelle qu’il convient de corriger si l’on veut construire une science véritablement inclusive et transformatrice.
Valorisation et impact sociétal de la recherche
Revenant sur le rôle stratégique de la recherche dans la transformation économique et sociale, la Professeure Marie Claire Yandju, Secrétaire générale à la recherche, a plaidé pour une valorisation scientifique adaptée aux besoins sociétaux. Elle a cité plusieurs expériences africaines réussies ayant conduit à la transformation industrielle à partir des résultats de la recherche universitaire.
Dans la même perspective, Madame Nicole Nzambi a présenté l’OIPR (Outil Intégré de Planification et de Recherche) comme une plateforme stratégique de coordination, de suivi et de promotion de la recherche transdisciplinaire à l’UNIKIN.
Les cinq formes de valorisation selon le Professeur Michel Bisa
Intervenant dans le même registre, le Professeur Michel Bisa Kibul a proposé une typologie des formes de valorisation de la recherche, articulée autour de cinq axes :
- Les publications scientifiques, vecteurs de diffusion du savoir ;
- Les transferts technologiques, pour connecter universités et industries ;
- La propriété intellectuelle, comme moteur de compétitivité ;
- Les partenariats industriels, catalyseurs d’innovation appliquée ;
- La création de start-ups universitaires, gages d’autonomie économique et de durabilité.
Poursuivant sa réflexion sur la valorisation de la recherche, le Professeur Michel Bisa Kibul a mis en exergue le rôle stratégique de l’Incubateur du Génie Scientifique Congolais (IGSC) comme levier institutionnel de transformation des résultats scientifiques en innovations concrètes. Il a souligné que l’IGSC constitue un pont entre la recherche académique et l’entrepreneuriat technologique, favorisant la maturation des projets portés par les chercheurs et étudiants congolais. Dans cette logique, la valorisation scientifique ne se limite plus à la publication, mais s’étend vers la création de start-ups, la gestion de brevets, et le transfert de technologies adaptées au contexte local. Pour le Professeur Bisa, cette dynamique incarne la vision d’une université productive, au service du développement national et de la souveraineté scientifique de la RDC.
Expériences et innovations concrètes
Enfin, plusieurs expériences pratiques ont illustré la vitalité de la recherche transdisciplinaire à l’UNIKIN :
- La domestication des chenilles comestibles, projet de sécurité alimentaire présenté par le Professeur Kambashi ;
- La conservation du manioc par séchage, portée par le Professeur Bukamba Tshanga ;
- Et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les protocoles de recherche, exposée par le Professeur Kasoro, soulignant les opportunités et défis liés à la transformation numérique du savoir.
Vers une gouvernance scientifique intégrée
En clôture, les participants ont unanimement appelé à la consolidation d’une gouvernance scientifique intégrée, fondée sur la mutualisation des compétences, la co-construction du savoir et la valorisation des résultats à impact social.
Le colloque s’achève ainsi comme un moment fondateur de réflexion et d’orientation, plaçant la recherche transdisciplinaire au cœur de la renaissance universitaire et du développement durable en République Démocratique du Congo.
Cellule de communication et vulgarisation de l'OG
Alphonse Muluba


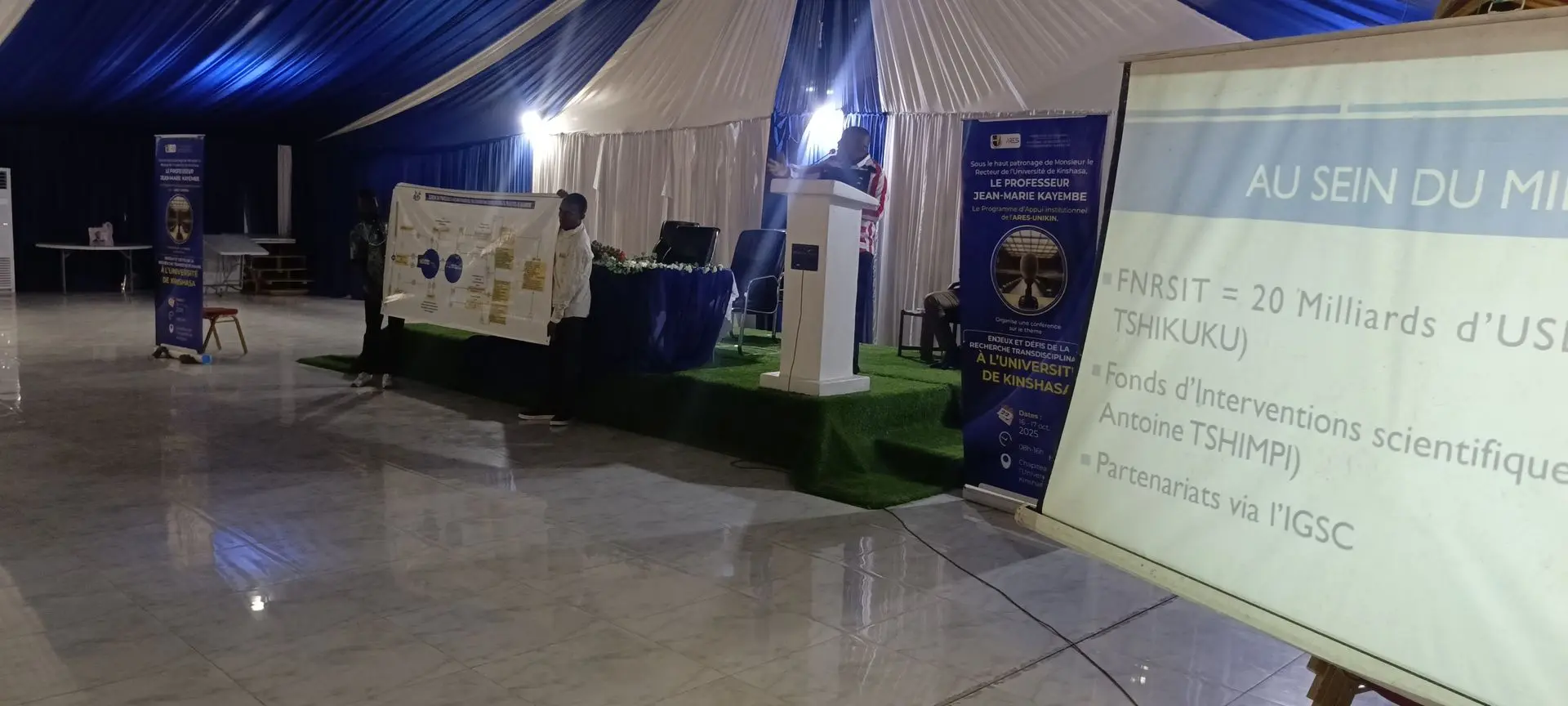


UNIKIN : Clôture du Colloque sur la Recherche Transdisciplinaire