À un moment donné, la technologie peut nous contrôler et commander comme la drogue
Il nous faut un esprit critique et une intermédiation instrumentale pour éviter d'être comme le sorcier qui a inventé une magie dont il ne sait plus se libérer. L'IA s'inscrit dans la continuité de l'invention de l'écriture, de la machine, de l'informatique pour venir en appui à son cerveau.
La machine peut venir comme une source d'imbécilisation collective
Il faut une éthique et une intelligence humanitaire pour les usages raisonnables et contextuels par rapport aux lieux spécifiques. Chaque technologie, l'IA doit être adaptée aux besoins locaux et aux réalités congolaises. Chaque invention a une dose idéologique qui peut viser à dominer les autres. D'ailleurs l'IA est plus développée par les USA et la Chine qui se font une guerre terrible. L'UE elle-même s'est avouée en retard.
Hommage du petit Emile BONGELI au Vieux Pascal PAYANZO Ntsomo
MAÎTRE des Maîtres des Maîtres
J’ai connu le Vieux de loin à l’Université Libre du Congo où il prestait comme enseignant quand, élève des années terminales au Collège du Sacré-Cœur de Kisangani, nous admirions, avec mes condisciples, ces grands frères universitaires à qui le régime de l’époque avait distribué de belles voitures Toyota (la marque venait d’être introduite à Kisangani).
Cet homme que je voyais de loin à Kisangani débarque à l’UNAZA, Campus de Lubumbashi comme professeur au Département de sociologie où je suis inscrit en seconde année de graduat. Avec mes collègues, nous le recevons comme enseignant des théories sociologiques.
Nous avions déjà été initié à la sociologie par les Professeurs Ferdinand NGOMA, MUNZADI Babole, MALEMBE Tamandiak, BOLA Nteto, KAJIKA Lumpundu… sans oublier le Belge Jacques FROMONT avec son schéma sociologique.
La spécificité de PAYANZO - que nous appelions déjà affectueusement PAPA malgré son jeune âge compte tenu de son caractère étonnamment jovial – est de nous avoir appris les théories sociologiques qui avaient pris ancrage en Amérique d’où il venait de défendre sa thèse de doctorat. En effet, si la sociologie est une invention européenne, c’est aux Etats-Unis, nouvelle société organiquement organisée autour de l’industrialisation naissante sur fond de la philosophie positive bourgeoise (Comte), pragmatiste (C. Peirce, W. James, J. Dewey, H. Mead), utilitariste (J. Bentham, J. S. Mills), à solidarité par intérêts (E. Durkheim), société où toutes les considérations humanistes sont noyées dans l’atonie des calculs égoïstes (K. Marx), c’est donc là que cette nouvelle science prend corps pour résoudre les défis posés par les complexités nouvelles du capitalisme naissant. En fait, il s’agit d’un monde débarrassé des conservatismes théologico-métaphysiques du vieux monde (aujourd’hui Vieille Europe) auquel les ancêtres (les Kuluna d’Europe) ont tourné le dos. Ici, est vrai ce qui est productif des résultats utiles et utilisables, ce qui justifie le rejet des spéculations philosophiques au profit de la sociologie, qui dit ce qui est et non ce qui devrait être.
C’est donc PAYANZO qui nous livre les différentes facettes, les différents -ismes de la sociologie américaine avec des noms comme T. Parsons, R. K. Merton, W. Mills, Lazarsfeld, M. Mead, B. Malinowski, Easton, Sorokin, etc. Le raisonnement sociologique basé sur l’analyse des faits sociaux observables, c’est ce à quoi nous initia le sympathique professeur Payanzo qui, toujours avec sa patience angélique et son sourire (parfois rire) qui ne le quittait jamais, répondait aux questions incessantes de Ngokwey, Muluma, feu Kinghombe, Lando, Shomba, Osokonda, Lapika… sans oublier le frêle Bongeli ! Le structuro-fonctionnalisme, le systémisme eastonien, l’empirisme anglo-saxon, le pragmatisme et l’utilitarisme américains… voilà les enseignements de Payanzo qui sont venus compléter ceux dispensés par Ngoma et les autres sur les différentes écoles nationales de la sociologie européenne.
Cette base de la sociologie officielle sera bousculée par la venue en 1974 des sociologues de l’ULB, notamment Mwabila et Mbela qui emmènent des problématiques nouvelles. C’est ainsi que pour mon mémoire de licence, je choisirai (on choisissait à l’époque) de travailler sous la codirection de Payanzo comme Directeur et Mbela comme co-Directeur. C’était en 1975.
Si plus au niveau post-universitaire, j’opterai pour la démarche critique induite par Mwabila dans un cerveau déjà préparé par la rencontre prématurée (moi-même encore élève en 4ème gréco-latine) avec B. Verhaegen. Toutefois, je dois avouer que la contre-sociologie de Mwabila, je ne l’aurai en aucun cas comprise sans les bases fondamentales solidifiées par les enseignements de Payanzo. Je risquai de devenir un marxiste mécaniciste, criticiste déconnecté (critique pour la critique) comme on en a connu dans le monde. C’est pourquoi, j’écrirai dans mon premier ouvrage sur le métier de sociologue en RDC : Payanzo nous a appris la sociologie, Mwabila nous a appris la contre-sociologie. Et nous avons réalisé la synthèse des deux dans une fusion-triangulation méthodologique féconde et intellectuellement fécondante.
La complémentarité entre mes deux maîtres ne m’a jamais quitté un seul instant dans la pratique de mon métier de sociologue. C’est donc fidèle à mes deux maîtres que, quand je parle des paradigmes comme préalables épistémologiques à toute activité scientifique, je m’oppose résolument au radicalisme des uns et des autres, comme dans les querelles d’école à Lubumbashi d’heureuse mémoire, pour m’inscrire dans une vision d’anarchisme méthodologique (Rezsohazy), fait de fusion-triangulation méthodologique plus fertilisante et plus réaliste, plus respectueuse des spécificités conjoncturelles. Autant analyser une situation sociale de manière purement fonctionnaliste obscurcit certaines réalités sociales et ne pousse pas au changement, autant la critique portée sur un fait social qu’on ignore ne peut qu’être déplacée, mécanique, idéaliste, criticiste, donc dangereuse et peut pousser au fanatisme. C’est ainsi qu’en prônant le paradigme de la cohérence, je plaide pour cette fusion entre fonctionnalisme (Payanzo) et critique (Mwabila) dans l’approche des phénomènes sociaux.
Sur le plan humain, le Vieux constituait toute une école de comportement social positif. Il inspirait la bonhomie, la joie éternelle. Un jour, à sa sortie de la salle de délibération, il me trouve attristée en attente des résultats. Il éclate de rire avec ces mots : regardez-moi ce type ! Il est triste alors qu’il vient de réussir avec Distinction ! Leçon : pourquoi chercher à se créer des occasions de tristesse ?
Autre leçon de la nécessité de ne rater aucune occasion de se réjouir : Payanzo me brandit le cas du discours improvisé de LUMUMBA à l’occasion de la cérémonie de l’octroi de l’indépendance le 30 juin 1960 : cette improvisation, qui a pourtant évoqué des problèmes sérieux et justes, n’étaient pas opportuns en ce moment et en ce lieu de réjouissance tant pour des colons (perdants) que pour des désormais émancipés (gagnants) ! Moralité : quand il y a opportunité d’être joyeux, ne la gaspiller pas car la vie est pleine d’occasions de stress et rien ne vaut la peine d’en chercher délibérément. Quand les gens se réjouissent, ce n’est pas le moment d’évoquer les sujets qui fâchent !
Une autre leçon de fairplay qui m’a marqué jusqu’à ce jour : au Campus de la Kasapa, des manifestations estudiantines surviennent en pleine session d’examens. Après une semaine de troubles, la session reprend. Fatigués et surtout stressés, nous demandons à Papa Payanzo de nous accorder la facilité du livre ouvert. Il nous l’accorde instantanément en souriant aimablement et nous passâmes l’épreuve comme souhaité, libérés du stress vécu après des émeutes estudiantines relaxantes ! C’était pourtant un examen comme les autres, mais passé dans un climat exempt d’angoisse. Depuis lors, j’ai réalisé que beaucoup de nos étudiants échouent suite à des angoisses générées par des attitudes professorales peu rassurantes, arrogantes et menaçantes. Instruit par cette expérience, devenu moi-même enseignant, tous mes examens se déroulent à livre ouvert, même les épreuves orales.
Un jour, mon vieux a été victime d’un cambriolage de Téléphone arraché par un Kuluna, emportant ainsi des données utiles et difficiles à reconstituer. Il me parla de l’exploit de son cambrioleur en riant ! Il y a deux mois, je venais moi-même de perdre mes deux ordinateurs avec plusieurs données non conservées. A la place du chagrin, j’ai vu m’envahir le sourire du Vieux et mon entourage croit à peine que j’ai connu une perte des données si précieuses pour mes activités scientifiques ! Et la vie continue !
Quel que soit le degré de votre colère, il suffisait de voir le Vieux pour recevoir une cure anti-fâche, anti-énervement, anti-adrénaline… et en sortir avec sourire !
Nous avons aussi appris à diriger des thèses à ses côtés : empathie avec l’élève, des observations pertinentes dans un langage doux, emprunt de courtoisie pour rassurer l’impétrant et l’éloigner des angoisses des examinés. Après tout, c’est un futur collègue, n’est-ce pas ? C’est pourquoi, je le considère comme MAÎTRE des Maitres (ma génération) des Maîtres (génération LUBO). Il l’est réellement. Voilà pourquoi il survit et survivra, triomphant de cette mort qui l’arrache de nos vues, qui allège ses souffrances de l’âge… mais ne le fera pas disparaitre. Nous l’aimions et continuerons à l’aimer.
C’est pourquoi, malgré la forte envie de pleurer pour cette douloureuse séparation, je pense justement à mon Vieux, je le vois, comme d’habitude, souriant et ne résiste pas, moi-même à sourire, bien sûr stoïquement car la peine est présente dans toute sa ‘’lugubrité’’.
Adieu, MAÎTRE des Maitres de Maitres !
Petit na yo BONGELI



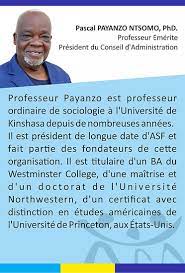
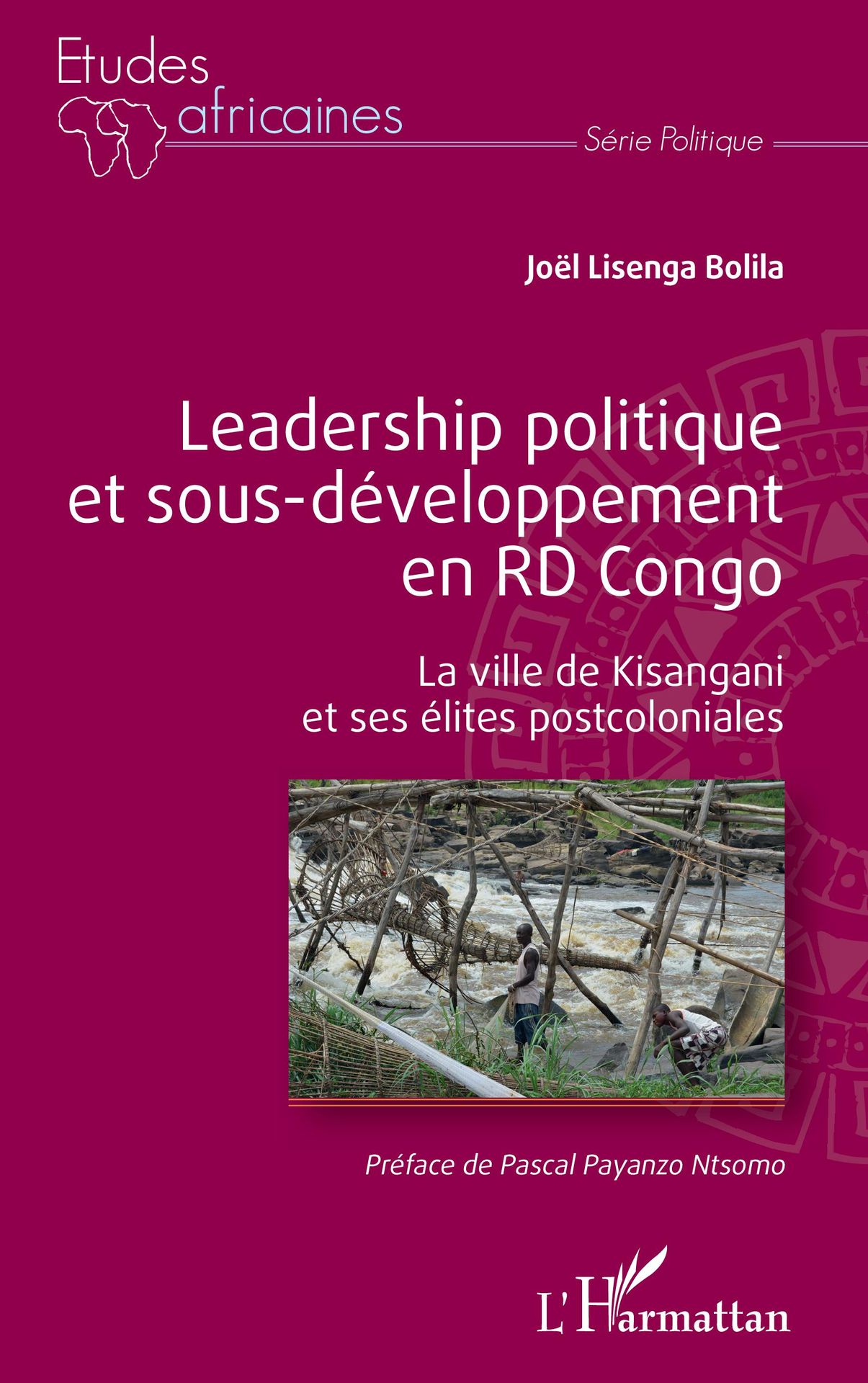
Le Prof. Émile Bongeli : l'Intelligence Artificielle, perpétuelle redynamisation sociétale